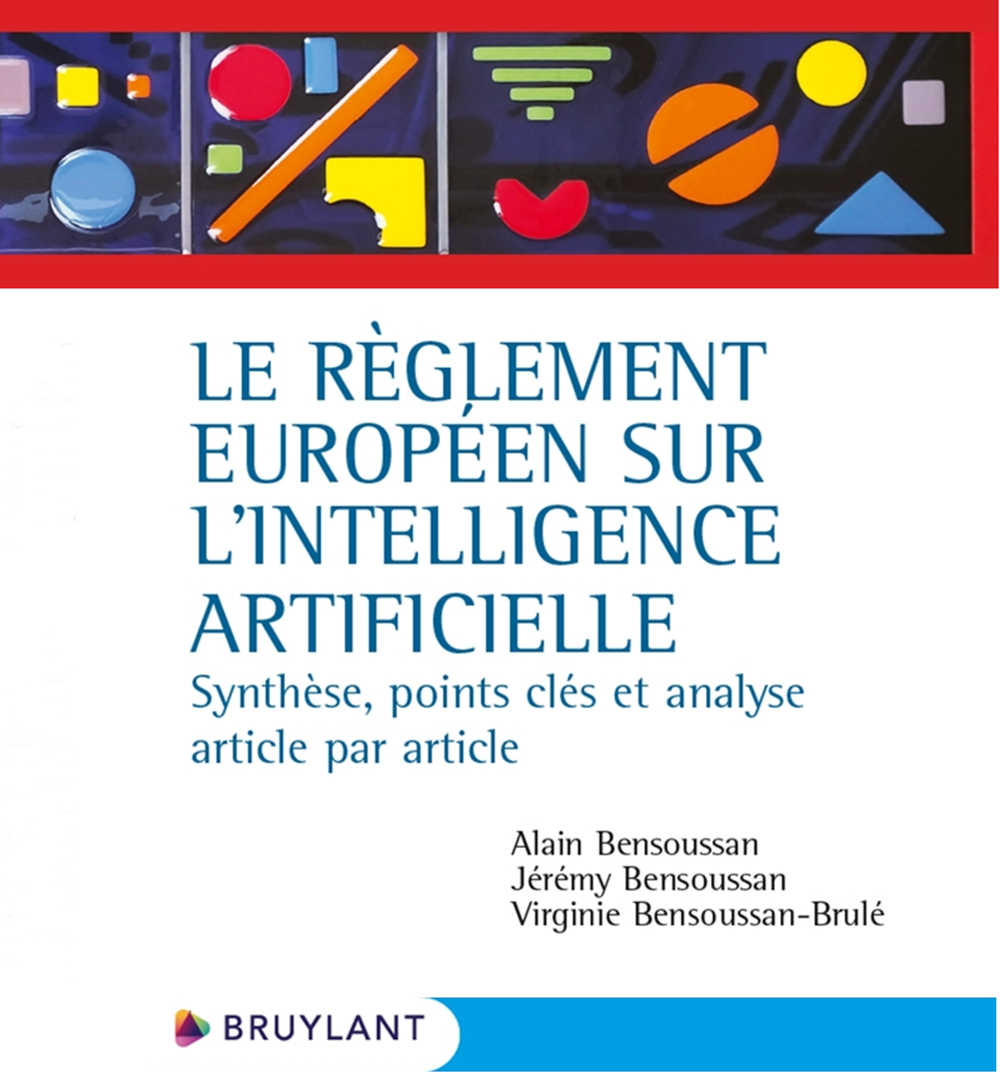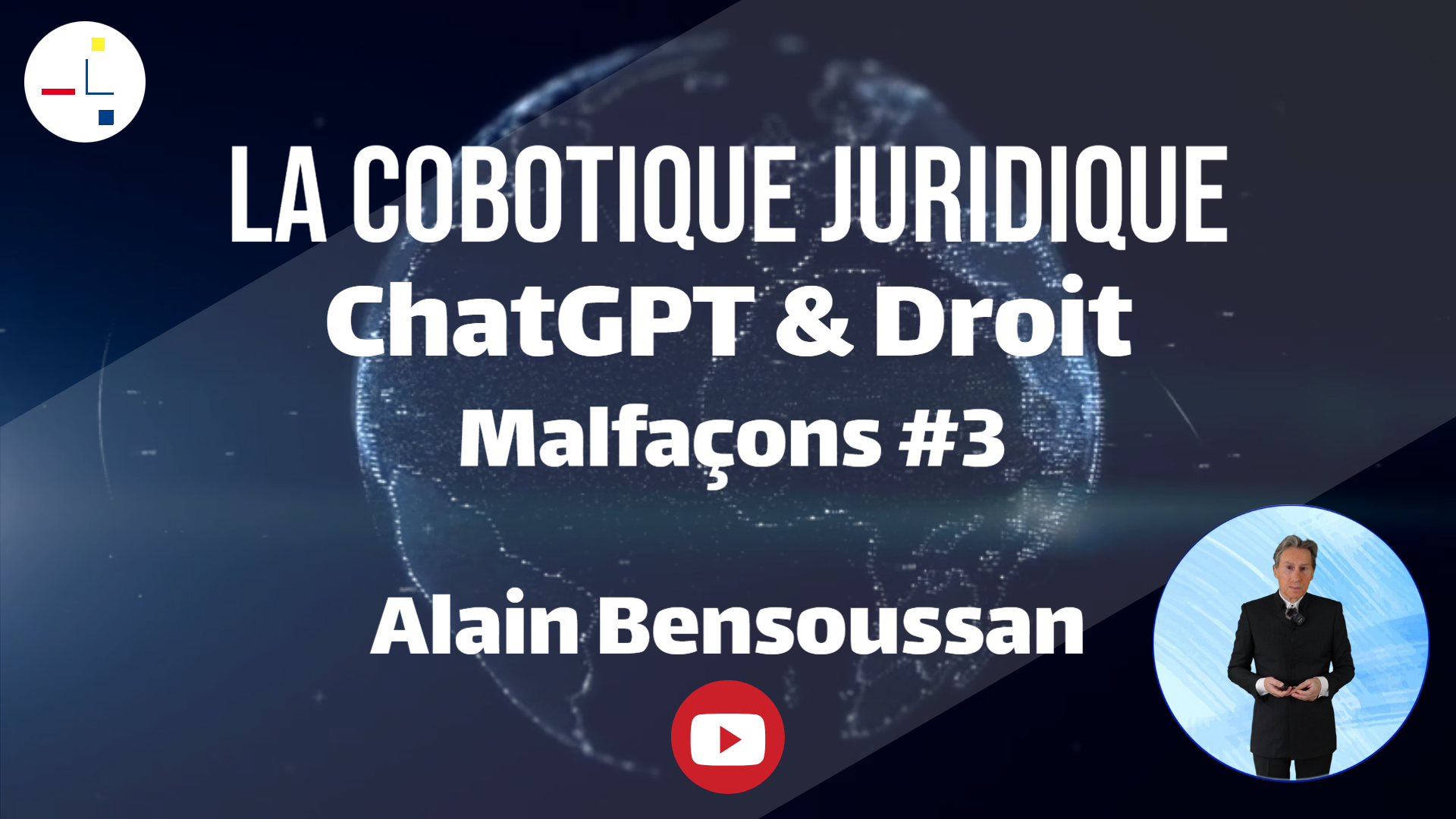Annulation de la marque SAINTEM pour atteinte à l'AOP Saint-Emilion
1. AOP 1 / Marque 0
Dans une décision du 4 avril 2025 (1), l’INPI prononce l’annulation de la marque française SAINTEM pour atteinte à l’AOP SAINT-EMILION.
Cette décision fait suite à la demande d’annulation introduite conjointement par le Conseil des vins de Saint-Emilion et l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO). Elle reprochaient à cette marque de porter atteinte à l’appellation d’origine protégée (AOP) SAINT-EMILION.
Malgré l’ancienneté de la marque enregistrée en 2001 et le fait que celle-ci était exploitée pour commercialiser des vins bénéficiant effectivement de la célèbre appellation, l’INPI fait droit à cette demande.
2. Une marque et un conflit anciens
Si l’intervention de l’INAO est nouvelle, le litige opposant le propriétaire de la marque au Conseil des vins de Saint-Emilion et à ses instances ne l’est pas.
En 2001, le viticulteur inspiré dépose une série de marques SEINTEM, SAINT’AYME et SAINTEM pour désigner les bières, vins et services de publicité. Attirant l’attention de l’Union des producteurs de Saint-Emilion dirigée par le vice-président Conseil des Vins de Saint-Emilion, ces marques et plus particulièrement la marque SAINTEM font l’objet de négociations en vue d’un rachat dès 2008.
Suite à l’échec vraisemblable des discussions, le Conseil des Vins de Saint-Emilion agit en déchéance pour défaut d’usage sérieux des marques SEINTEM et SAINTEM devant l’INPI.
Par décision du 26 juin 2023, l’INPI constate l’absence d’usage de la marque SEINTEM et prononce sa déchéance totale. Fin de partie pour SEINTEM…
Pas pour SAINTEM en revanche. Suite à la décision de déchéance totale rendue le 18 avril 2023, le viticulteur forme un recours devant la Cour d’appel de Bordeaux. Par décision du 17 mai 2024, celle-ci réforme partiellement la décision de l’INPI et limite la déchéance aux seules bières et services de publicité. La marque SAINTEM est donc maintenue pour les vins.
Avant même que cette décision ne soit rendue, le Conseil des Vins de Saint-Emilion et l’INAO ouvrent un nouveau front, sur le terrain cette fois ci de la nullité et de la protection des AOP.
Deux motifs de nullité sont invoqués :
• l’atteinte à l’appellation d’origine protégée antérieure SAINT-EMILION ;
• le caractère illicite du signe dont l’usage est légalement interdit en application de l’article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure, applicable à la marque déposée en 2001.
L’occasion de revenir sur les règles de protection des appellations d’origine protégées mais également sur l’application des règles de prescription de marque modifiées par la réforme de 2019.
3. La prescription écartée
Suite logique de l’ancienneté du litige, le titulaire de la marque invoquait la prescription de l’action en nullité de la marque faisant valoir puisque les demandeurs avaient connaissance de l’enregistrement de la marque litigieuse depuis plus de cinq ans.
Pour rappel, avant la réforme de 2019, l’action en nullité était soumise à la prescription de droit commun de l’article 2224 du Code civil (2). Il en résultait que l’action en nullité d’une marque était enfermée dans ce délai de 5 ans, quel que soit le motif de nullité. Cette solution avait donné lieu à moult débats doctrinaux, notamment dans le cadre d’une autre affaire de marque viticole, CHEVAL BLANC (3).
Désormais, l’article L.716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle (4) pose le principe d’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque.
S’agissant du droit transitoire, la règle rappelée par l’INPI dans sa décision du 4 avril 2025 est la suivante : « l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle n’est pas applicable aux actions en nullité de marque dont la prescription était déjà acquise lors de l’entrée en vigueur de la loi PACTE le 24 mai 2019 » (5).
La question était donc de savoir si la prescription était acquise au jour de l’entrée en vigueur de la loi PACTE le 24 mai 2019. Autrement dit, le Conseil des Vins de Saint-Emilion et l’INAO connaissaient-ils ou auraient-ils dû connaître la marque depuis plus de cinq années ?
3.1. Prescription acquise au jour de l’entrée en vigueur de la loi PACTE ?
Au soutien de son argumentaire, le viticulteur faisait notamment valoir :
• la publication du dépôt de la marque au BOPI le 27 avril 2001 ;
• les négociations intervenues en vue du rachat de la marque en 2008 ;
• la demande en déchéance formée en 2008 ;
• les déclarations de conditionnement des vins SAINTEM adressées à Quali Bordeaux, organisme de contrôle sous tutelle de l’INAO et l’attestation remise par l’INAO en 2012 l’habilitant à conditionner en AOC Saint-Emilion…
Peine perdue. L’INPI énonce tout d’abord que pour apprécier si chacun des demandeurs avait ou aurait dû avoir connaissance de la marque contestée plus de cinq ans avant le 24 mai 2019, « cette connaissance doit être établie par des preuves tangibles et ne saurait être affirmée sur la base de suppositions ou probabilités ».
Ce faisant et au terme d’une appréciation (très) stricte, l’INPI écarte chacune des pièces produites par le viticulteur pour retenir qu’il devait « être considéré comme non établi que les demandeurs aient eu, ou auraient dû avoir, connaissance de l’existence de la marque contestée plus de cinq ans avant l’entrée en vigueur de la loi PACTE le 24 mai 2019, de sorte que la prescription de la présente demande en nullité n’était nullement acquise à cette date ».
Sans reprendre l’analyse de chaque pièce, il est intéressant de noter que l’INPI écarte expressément la date de publications au BOPI du dépôt de la marque et de son renouvellement.
3.2. Valeur de la date de publication
Concernant la publication du dépôt de la marque, l’INPI rappelle de manière logique et imparable que celle-ci ne peut constituer le point de départ de la prescription d’une action en nullité dans la mesure où une telle action ne peut être engagée qu’après l’enregistrement de la marque.
Les autres pièces et publications sont également écartées au motif que rien ne démontrait que le renouvellement de la marque contestée en 2011 ait été porté à la connaissance des demandeurs qui n’avaient pas mis en place de surveillance de marques…
La solution est sévère même si la jurisprudence majoritaire tend à procéder à une appréciation concrète de la date à laquelle le demandeur a connu ou aurait dû connaitre le motif de nullité permettant d’exercer l’action.
En ce sens, la Cour d’appel de Bordeaux avait, dans l’affaire CHEVAL BLANC précitée retenu la publication BOPI comme point de départ au motif que celle-ci avait pour but de rendre la marque opposable aux tiers (6). Plus récemment, la même Cour a jugé prescrite l’action en nullité à l’encontre de la marque CHATEAU LA ROSE en procédant à une appréciation combinée des éléments produits pour retenir que le requérant avait connaissance des faits lui permettant d’engager l’action en nullité (7).
Le titulaire de la marque ayant récemment formé un recours à l’encontre de cette décision, il sera intéressant de voir si la Cour saisie confirme la stricte appréciation du point de départ de la prescription.
4. Une évocation prohibée de l’AOP SAINT-EMILION
L’autre point d’intérêt de la décision réside, à l’évidence, dans l’appréciation de l’atteinte à une AOP.
Les demandeurs sollicitaient en effet l’annulation de la marque sur le fondement de l’AOP SAINT-EMILION reconnue en France dès 1936 et enregistrée au niveau de l’Union européenne en tant qu’AOP en 1973 pour le vin.
L’AOP SAINT-EMILION est ainsi protégée au titre de l’article 118 quaterdecies du règlement (CE) n° 1234/2007 du conseil (règlement « OCM unique »). Aux termes de cet article, les AOP sont protégées contre « toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que “genre”, “type”, “méthode”, “façon”, “imitation”, “goût”, “manière” ou d’une expression similaire ; (…) » (8).
En l’absence d’identité entre l’AOP SAINT-EMILION et la marque SAINTEM, l’INPI s’est attaché à examiner si la marque en question constituait une « évocation » interdite par le Règlement.
Procédant de manière didactique, l’INPI énonce les règles appliquées pour procéder à une telle appréciation.
4.1. Règles d’appréciation de l’atteinte à une AOP
Ainsi, il convient de retenir en synthèse :
• qu’il convient de rechercher si le « consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé » est amené, en présence du signe déposé, à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant du label ;
• cette évocation doit être distinguée du risque de confusion, l’INPI rappelant qu’il « peut y avoir évocation même en l’absence de tout risque de confusion » ;
• l’évocation doit ainsi être recherchée par une appréciation globale, incluant l’ensemble des éléments pertinents du cas d’espèce et ne présuppose pas une identité ou une similarité entre les produits et services visés par la marque et ceux protégés par l’AOP.
Appliquant ces règles, l’INPI procède ensuite à une comparaison visuelle, phonétique et intellectuelle des signes en comparaison. Retenant les « importantes similitudes visuelles et phonétiques » entre les signes ainsi que « la renommée de longue date de l’appellation SAINT-EMILION », l’INPI parvient à la conclusion selon laquelle le signe SAINTEM peut faire penser à une forme abrégée de l’AOP SAINT-EMILION.
Ce n’est que dans un second temps que l’INPI prend en considération les produits concernés. Dans ce cadre, il retient qu’eu égard à l’identité des produits en cause – les vins – le signe SAINTEM constitue une « évocation » de l’AOP SAINT-EMILION.
4.2. Tromperie malgré le bénéfice de l'AOP
Le fait que produits offerts sous la marque bénéficient de l’AOP ne permet pas d’échapper à la définition et partant à l’annulation de la marque comme l’énonce expressément l’INPI :
« l’appréciation du bien-fondé d’une demande en nullité de marque doit s’effectuer en prenant en considération les produits tels que désignés dans le libellé de la marque, lesquels en l’occurrence sont des vins, sans autre précision. A titre surabondant, il convient de rappeler qu’il a été jugé qu’en vertu des dispositions européennes prévoyant la protection des AOP viticoles, toute ‘forme imitante ou évocatrice’ de l’AOP est interdite, ‘y compris pour un vin bénéficiant de ladite appellation’ ».
Ainsi, la motivation révèle moins une volonté de protection du consommateur face à un risque de tromperie qu’une volonté de protéger l’AOP en tant que telle.
Le motif de la sanction n’est pas le risque de tromperie mais plutôt l’interdiction d’appropriation d’un signe susceptible d’affaiblir l’AOP.
La solution répond ainsi clairement aux missions et objectifs rappelés par l’INAO dans son Contrat d’objectifs & de performance 2024-2028 concernant la protection des SIQO (9).
5. Marque SAINTEM : un usage illicite de l’AOP
L’INPI ne pratique pas l’économie des moyens. Aussi, même si la nullité est prononcée sur le premier motif invoqué, il se prononce également sur le second, à savoir le caractère illicite du signe.
L’INPI explique succinctement que, la marque contrevenant à la réglementation européenne sur les AOP, sont utilisation est légalement interdite. Elle doit donc également être annulée sur ce fondement.
L’INPI contourne ainsi l’absence de dispositions spécifiques au sein de la loi applicable de 1992 concernant les rapports entre une indication géographique et une AOP. Elle utilise comme fondement l’interdiction d’une utilisation « légalement interdite » d’un signe de l’ancien article L.711-3 b) du CPI pour justifier légalement sa décision.
6. Illustration de la puissance montante des AOP
La volonté de l’INPI de faire prévaloir l’AOP SAINT-EMILION ressort des différents raisonnements mis en place pour justifier légalement sa décision :
• une appréciation stricte de la fixation du point de départ de la prescription ;
• une interprétation tout aussi stricte de la nullité relative et
• l’établissement d’un raisonnement juridique équivoque.
pour retenir un motif de nullité absolue, qui n’apparaissait pas nécessaire, la nullité relative ayant déjà été retenue.
Cette insistance de l’INPI à renforcer la protection accordée aux AOP face à celle du droit des marques illustre l’importance grandissante de l’ensemble des indications géographiques, en ce compris les AOP, en tant que signes distinctifs et non seulement en tant que cahiers des charges devant être strictement respectés.
Le recours formé permettra de savoir si cette tendance est suivie par la Cour d’appel…
- INPI, 04-04-2025, NL24-0071 ;
- C. civ. art. 2224 ;
- Cass. com. 08-06-2017, n°15-21357, Legifrance
- L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle.
- CA Bordeaux, 22-10-2022, n°21/04291
- CA Paris, 19-04-2023, n°21/12725
- CA Bordeaux, 1ère, 25-10-2022, n°21-04291, Dalloz.fr
- Règlement (CE) n° 1234/2007, art. 118 quaterdecies ;
- INAO, Contrat d'objectifs & de performance 2024-2028, inao.gouv.fr

Virginie Brunot
Avocate, Directrice du département Propriété industrielle contentieux

Virginie Brunot
Avocate, Directrice du département Propriété industrielle contentieux
- Phone:+33 (0)6 13 28 95 88
- Email:virginie-brunot@lexing.law
Pour en apprendre davantage
Le Règlement européen sur l’intelligence artificielle constitue un outil essentiel pour comprendre les enjeux juridiques et techniques que pose le RIA (ou AI Act). L’ouvrage analyse et souligne les points clé et analyse article par article ce texte...
La cobotique juridique #3 : Les malfaçons. Ce troisième épisode détaille les différents facteurs de malfaçons et comment les corriger...
Virginie Brunot
Avocate, Directrice du département Propriété industrielle contentieux
Cécile Merveilleux du Vignaux, Avocate, Département Propriété industrielle Contentieux
Sommaire
- 1. AOP 1 / Marque 0
- 2. Une marque et un conflit anciens
- 3. La prescription écartée
- 4. Une évocation prohibée de l’AOP SAINT-EMILION
- 5. Marque SAINTEM : un usage illicite de l’AOP
- 6. Illustration de la puissance montante des AOP