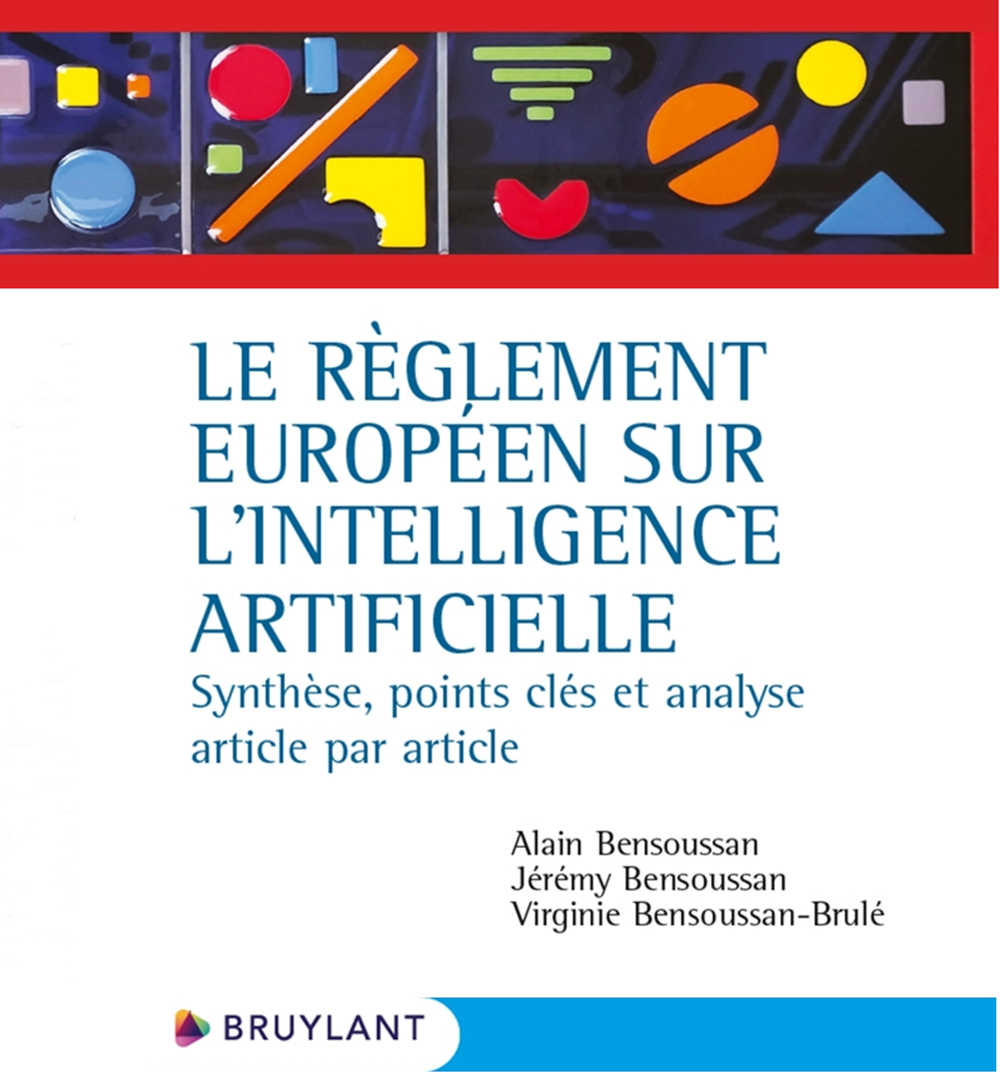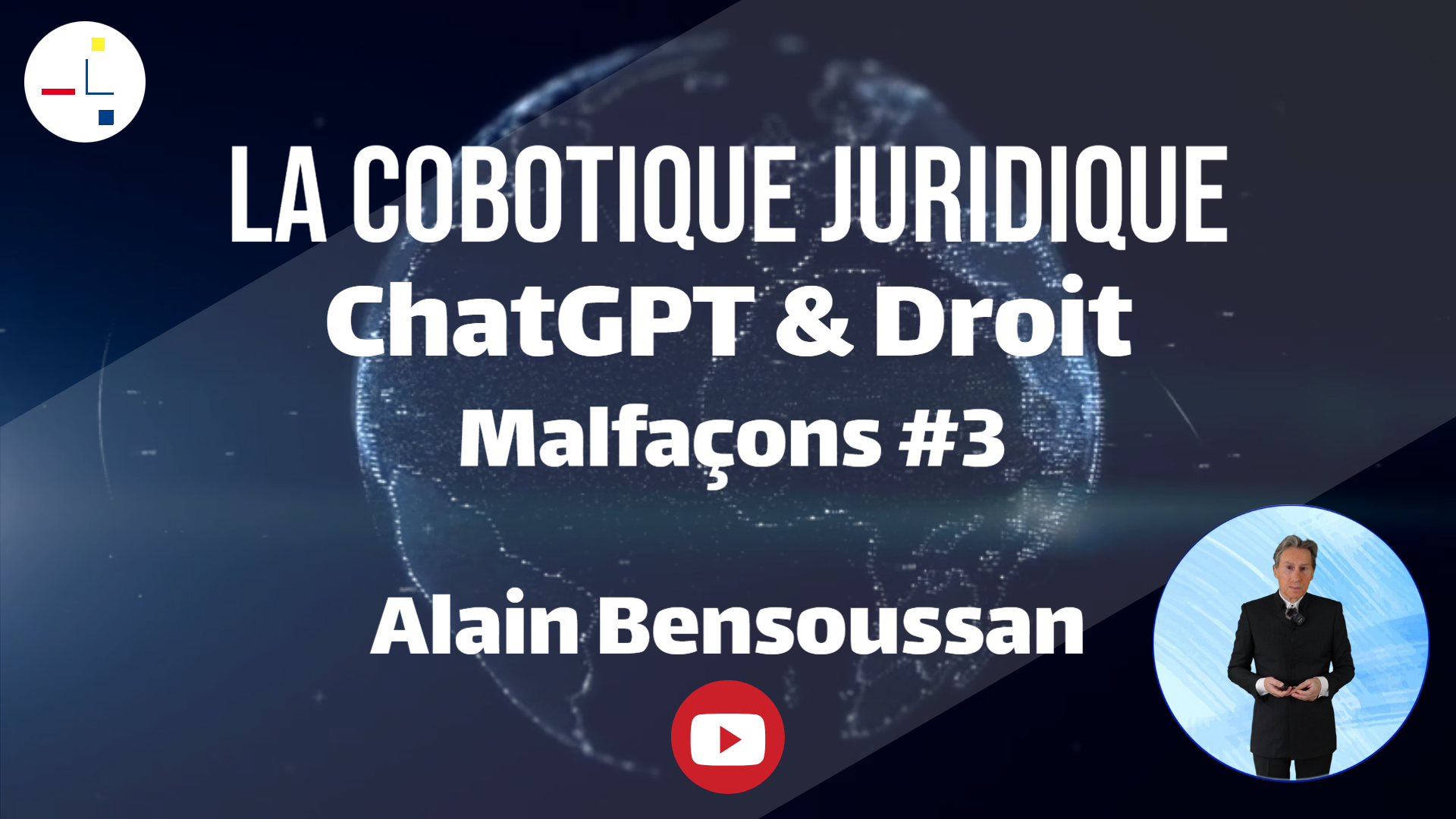Les entreprises de communication audiovisuelles, soutenues par les ligues professionnelles, ont obtenu plusieurs décisions du tribunal judiciaire de Paris enjoignant à des fournisseurs de VPN (Virtual Private Network) de bloquer l’accès aux sites diffusant illégalement des compétitions sportives, les dernières décisions ayant été rendues les 19 juin 2025 et 18 juillet 2025.

Entreprises de communication audiovisuelle contre la diffusion non autorisée
Piraterie sportive : les VPN sommés de bloquer l’accès
Titulaires ou licenciés exclusifs des droits de diffusion en France et outre-mer de manifestations sportives, Canal+ et beIN Sports France ont saisi à plusieurs reprises les juges en urgence, dénonçant une diffusion illicite massive de leurs programmes, rendue possible sur le territoire français via l’usage de VPN permettant de contourner les géoblocages.
Les entreprises de communication audiovisuelle au sens de l’article L. 216-1 du Code de la propriété intellectuelle invoquent une atteinte grave et répétée à leurs droits d’exploitation audiovisuelle sur le fondement de l’article L.333-10 du Code du sport qui permet aux titulaires de droits exclusifs d’agir contre tout acteur contribuant à la diffusion non autorisée d’événements sportifs.
Elles demandent à cet effet une injonction contre les fournisseurs de VPN afin qu’ils prennent toutes les mesures efficaces empêchant l’accès aux sites pirates à partir du territoire français.
Une contestation fondée sur la propriété intellectuelle
Piraterie sportive : les VPN sommés de bloquer l’accès
Dans chaque décision, le tribunal a reconnu la qualité à agir des entreprises de communication audiovisuelle en tant que titulaires de droits exclusifs de diffusion de manifestations sportives, et ce en vertu d’accords conclus avec les ligues professionnelles. A ce titre, elles étaient fondées à demander une injonction contre toute personne susceptible de contribuer à faire cesser une atteinte à leurs droits, les images piratées étant issues de leurs propres canaux de diffusion.
Contrairement aux objections des défendeurs, l’article L.333-10 du Code du sport n’exige pas une exclusivité intégrale des compétitions. Une exclusivité partielle suffit dès lors que les atteintes sont graves, répétées et émanant de services en ligne dont l’un des objectifs est la diffusion non autorisée de compétitions sportives.


Les VPN, facilitateurs d’accès aux contenus illicites
Piraterie sportive : les VPN sommés de bloquer l’accès
Les fournisseurs soutenaient qu’ils n’étaient ni hébergeurs, ni éditeurs et échappaient donc aux mesures coercitives. Le tribunal a rejeté cet argument, les fournisseurs de VPN étant des intermédiaires techniques au sens large du texte. En permettant de masquer l’adresse IP et de contourner les blocages, ils facilitent techniquement l’accès aux contenus illicites, ce qui les rend « susceptibles de contribuer » à faire cesser l’atteinte même sans responsabilité directe.
Ce critère fonctionnel, issu de la réforme de 2021, est conforté par le règlement DSA (UE 2022/2065) et la Recommandation de la Commission européenne du 4 mai 2023, qui mentionnent expressément les VPN comme services intermédiaires susceptibles d’usage abusif.
Mesures prononcées et modalités de mise en œuvre
Piraterie sportive : les VPN sommés de bloquer l’accès
Blocage massif ordonné
Le juge a ainsi ordonné par différentes décisions rendues en urgence le blocage sous trois jours de sites identifiés comme diffusant illégalement les compétitions pour toute la durée des saisons sportives 2024–2025. Il a ordonné également une extension automatique à tout site signalé par notification de l’ARCOM en application de l’article L.333-10 III du Code du sport.
Appréciation de la proportionnalité des mesures
Le juge écarte tout risque d’inconventionnalité. Il rappelle que les mesures ordonnées sont ciblées, limitées dans le temps et à leur objet, sans imposer de surveillance généralisée en conformité avec la Directive e-commerce et la Directive DSA. Il impose une obligation de résultat aux fournisseurs de VPN et non de moyen en invoquant la jurisprudence de la CJUE (affaire Telekabel, C-314/12, §64), par laquelle l’intermédiaire peut lui-même déterminer les modalités techniques les plus adaptées, pourvu que le résultat soit atteint efficacement et proportionnellement.

- TJ Paris 19-06-2025, n° 25/01464.
- TJ Paris 18-07-2025 n° 25/05968.
- Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 [modifié] relatif à un marché unique des services numériques (règlement sur les services numériques) dit DSA (Digital Services Act).
- Recommandation (UE) 2023/1018 du 4 mai 2023 sur la lutte contre le piratage en ligne des manifestations sportives et autres événements en direct.
- Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 [modifiée] relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»).
- CJUE 27-03-2014, C-314/12, affaire Telekabel.
Avec la collaboration de Cléo Carraz, stagiaire, Diplômée du master 2 Droit du patrimoine culturel de Paris Saclay.

Marie Soulez
Avocate, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux

Marie Soulez
Avocate, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux
- Phone:+33 (0)7 85 53 57 52
- Email:marie-soulez@lexing.law
Pour en apprendre davantage
Le Règlement européen sur l’intelligence artificielle constitue un outil essentiel pour comprendre les enjeux juridiques et techniques que pose le RIA (ou AI Act). L’ouvrage analyse et souligne les points clé et analyse article par article ce texte...
La cobotique juridique #3 : Les malfaçons. Ce troisième épisode détaille les différents facteurs de malfaçons et comment les corriger...