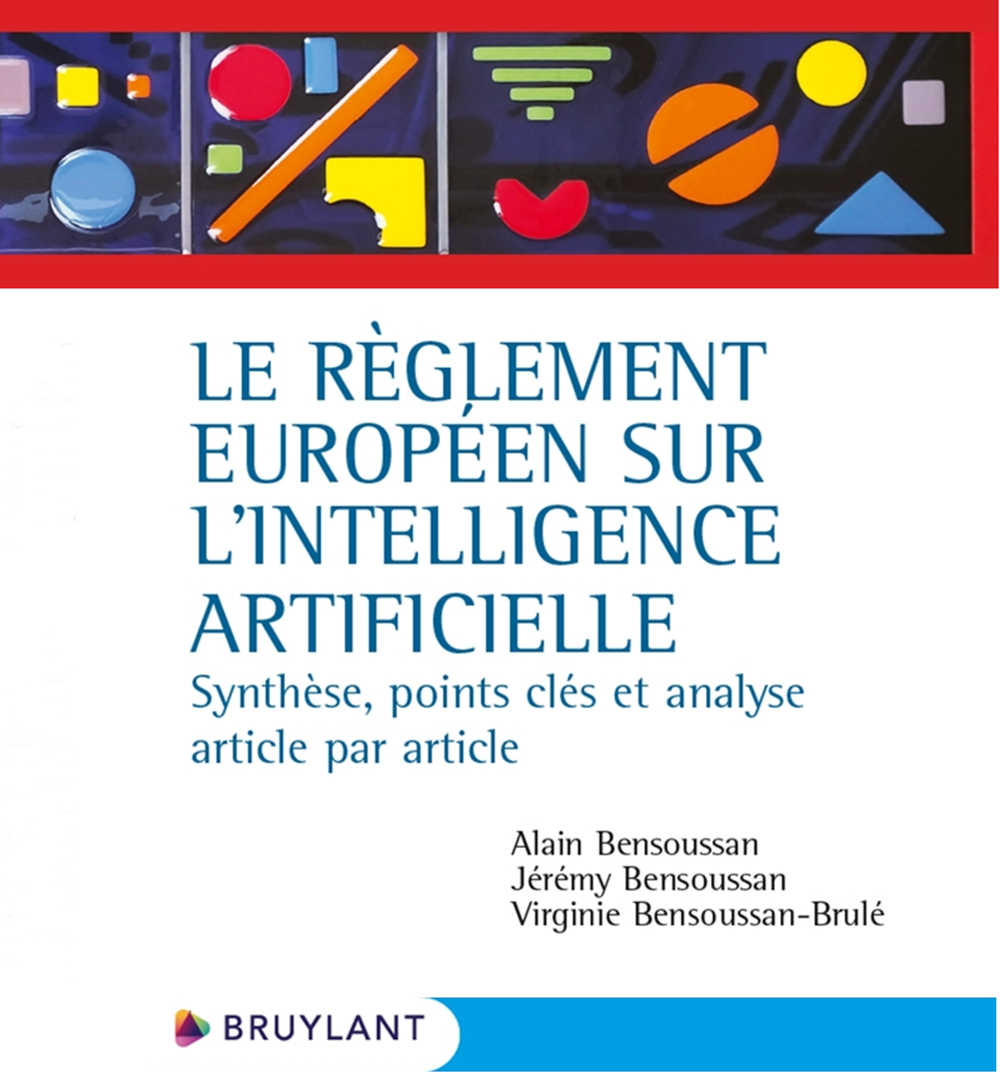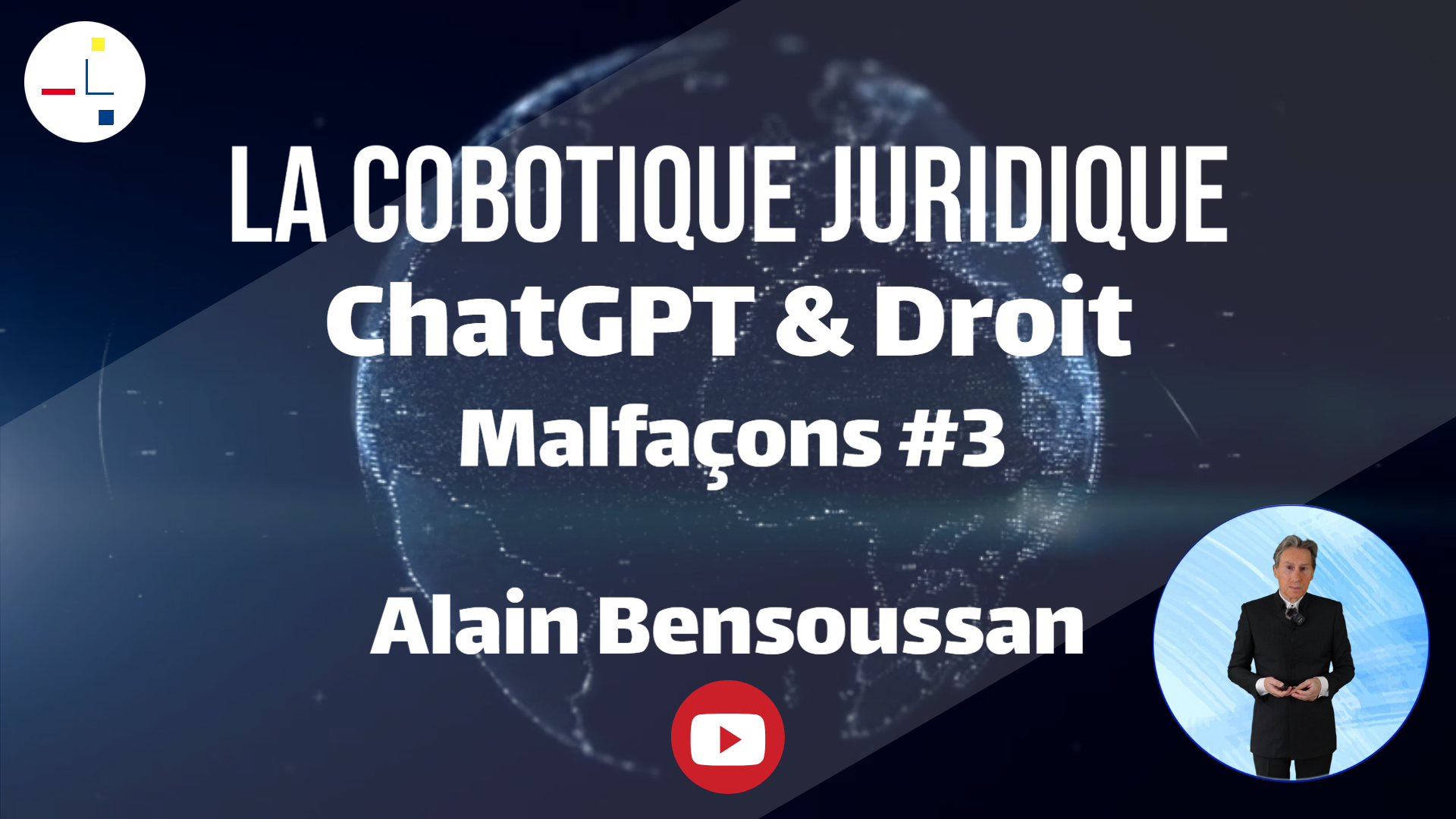Faut-il marquer toutes les images générées ou modifiées par intelligence artificielle ?
En février 2025, Google a commencé à intégrer SynthID, un tatouage numérique invisible, dans son application Google Photos. Cette technologie, développée par DeepMind, permet de dissimuler dans les pixels d’une image une signature qui en révèle l’origine ou les modifications apportées par l’IA.

Tatouage numérique à l’ère de l’IA
Le tatouage numérique à l’ère de l’intelligence artificielle
Cette démarche, qui vise à lutter contre les manipulations visuelles et les deepfakes, repose sur un procédé désormais central : le tatouage numérique.
Face à la multiplication des œuvres numériques, qu’il s’agisse d’images, de vidéos animées, de NFT ou de créations générées artificiellement, de nouveaux défis émergent, que ce soit pour retracer la diffusion d’un fichier, prouver l’authenticité, décourager la contrefaçon ou garantir la transparence d’un contenu généré par intelligence artificielle.
Le tatouage numérique deviendrait un levier de protection et de responsabilité dans les usages. Ainsi, selon la CNIL, ce procédé stéganographique désigne toute information, sous forme d’empreinte ou de filigranes numériques, intégrée dans un fichier permettant de retracer l’origine, l’auteur ou le processus de fabrication sans en altérer l’apparence ou limiter son usage.
Des mesures techniques prévues par le CPI
Le tatouage numérique à l’ère de l’intelligence artificielle
Le Code de propriété intellectuelle distingue deux catégories de mesures techniques destinées à protéger les œuvres d’utilisations non autorisées par les titulaires du droit d’auteur ou d’un droit voisin : les mesures techniques d’information et les mesures techniques de protection.
Les mesures techniques d’information
Elles désignent toute technologie, dispositif ou composant permettant au titulaire des droits d’intégrer électroniquement des informations sur l’œuvre. Ces informations permettent d’informer l’utilisateur des conditions et modalités de son utilisation (nom de l’auteur, type de licence, conditions d’utilisation).
Les mesures techniques de protection
Elles sont constituées par toute technologie, dispositif ou composant permettant d’empêcher ou de limiter les accès et utilisations non autorisées par l’auteur d’une œuvre ou son ayant droit.
Ces mesures permettent de contrôler l’usage du contenu une fois l’accès autorisé. Leur mise en œuvre peut prendre la forme d’un code d’accès, d’un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou un mécanisme de contrôle de la copie.


Le tatouage numérique
Le tatouage numérique à l’ère de l’intelligence artificielle
Le tatouage numérique est, selon, une mesure technique de protection ou d’information. Il consiste à insérer au sein de l’œuvre à protéger des informations sous forme d’un codage numérique, lesquelles seront reproduites automatiquement lors de chaque copie. Bien qu’il ne restreigne pas directement l’accès ou l’utilisation de l’œuvre, ce procédé permet de détecter les copies illicites, d’en identifier la source et de faciliter les actions en contrefaçon.
Sur le plan technique, il existe deux types de tatouage numérique :
► L’empreinte numérique, identifiant unique obtenu en appliquant une fonction de hachage à certaines données du fichier, agissant comme un numéro de série. Elle permet de vérifier l’intégrité du fichier et de détecter toute modification, sans toutefois contenir d’informations sur l’auteur ou l’origine de l’œuvre.
► Le filigrane numérique, code d’identification inséré dans le fichier comportant le nom de l’auteur ou le titulaire des droits de propriété intellectuelle ainsi qu’une mention de copyright. Il est généralement imperceptible à l’œil nu, mais persiste lors des copies, facilitant ainsi la traçabilité de l’œuvre.
Le watermarking
Le tatouage numérique à l’ère de l’intelligence artificielle
Le watermarking consiste à insérer un filigrane visible ou invisible dans une image, une vidéo ou un fichier audio.
► Le marquage invisible intégré au niveau des pixels ou des fréquences de son, ne modifie pas l’apparence de l’œuvre. Il peut contenir un identifiant, une date, un nom d’auteur. Il permet ainsi de prouver l’origine d’un fichier diffusé sans autorisation, de retracer la circulation d’une œuvre sur Internet ou encore d’affirmer une paternité artistique ou son absence en cas d’œuvres générées par intelligence artificielle.
► Le marquage visible est quant à lui un élément graphique ou textuel ajouté à une œuvre dans le but de montrer visiblement qui en est le propriétaire ou l’auteur.


Des enjeux juridiques forts
Le tatouage numérique à l’ère de l’intelligence artificielle
La protection des droits d’auteurs
Si la mention du copyright induite par l’insertion d’un filigrane numérique dans l’œuvre n’est pas obligatoire pour acquérir ou faire valoir des droits d’auteur en France, elle peut décourager la contrefaçon ou l’appropriation d’œuvres tout en gardant trace de la paternité de l’œuvre. Elle sera dissuasive, surtout si elle est accompagnée de dispositions rappelant le caractère illicite des reproductions et utilisations non autorisées de l’œuvre (copyright © ainsi que nom du titulaire et première date de divulgation).
Si ce procédé ne remplace pas les systèmes classiques de protection, il aura un rôle probatoire, permettant d’établir une contrefaçon en cas de reproduction illicite de l’œuvre, la preuve étant libre (art. 1358 du Code Civil). Ce fut le cas lors d’une récente décision du Tribunal judiciaire de Marseille reconnaissant pour la première fois que la blockchain pouvait constituer une preuve recevable pour établir la titularité des droits patrimoniaux sur des œuvres (1 et 2).
Indépendamment des actes de contrefaçon, le contournement de mesures techniques efficaces est, sous certaines conditions, sanctionné pénalement. En outre, l’auteur pourra en cas de modification ou de dénaturation de son œuvre invoquer la violation de son droit moral.
Les articles L.335-4-1 et L.335-4-2 du Code de la propriété intellectuelle sanctionnent toute atteinte volontaire aux mesures techniques de protection ou aux informations relatives aux droits voisins dans le but de contourner une protection ou de dissimuler une atteinte.
Un enjeu qui touche l’IA
Le tatouage numérique à l’ère de l’intelligence artificielle
L’entraînement sur des documents tatoués est rendu plus difficile. Dans le cas d’une image, le tatouage peut détériorer la qualité de l’image et donc la performance du modèle entraîné. Pour autant dans l’affaire LAION c/ Robert Kneschke (3), LAION avait téléchargé une copie d’une photo du photographe contenant un tatouage numérique pour créer et mettre à disposition des sets de données d’entraînement. Ce tatouage a apporté la preuve d’une copie réalisée sans autorisation de son auteur, exposant le contrefacteur au non-respect des droits d’auteur.
Dans une autre affaire, Getty Images (US) Inc and Others c/ Stability AI Ltd, Stability AI (4) avait récupéré 12 millions d’images pour entrainer et développer « Stable Diffusion » dont les résultats reproduisaient des parties substantielles de ses œuvres protégées, voire dans certains cas en conservant les filigranes de Getty. Le système d’intelligence artificielle n’avait pas pu enlever le watermarking de Getty Images.
Des systèmes analogues (5) au tatouage numérique visant à rendre impossible ou perturber l’apprentissage de l’œuvre par un système d’IA par des techniques de « data poisoning » sont explorés, empêchant ainsi la reproduction ou la reconnaissance de ces œuvres.

- Tribunal judiciaire de Marseille, 20 mars 2025, n°23/00046, (Dalloz Actualité).
- Marie Soulez et Cléo Carraz, « La blockchain est un mode de preuve désormais accepté », Lexing.law, 26 juin 2025.
- LG Hamburg, Urteil vom 27 septembre 2024, n° 310 O 227/23, LAION c/ Robert Kneschke (Dalloz Actualité).
- United Kingdom, Royal Courts of Justice, 14 janvier 2025, Getty Images vs Stability AI, Neutral Citation Number: [2025] EWHC 38 (Ch), Case No: IL-2023-000007, (Courts & Tribunals Judiciary UK).
- About The Glaze Project, glaze.cs.uchicago.edu.
Avec la collaboration de Cléo Carraz, stagiaire, Diplômée du master 2 Droit du patrimoine culturel de Paris Saclay.

Marie Soulez
Avocate, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux

Marie Soulez
Avocate, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux
- Phone:+33 (0)7 85 53 57 52
- Email:marie-soulez@lexing.law
Pour en apprendre davantage
Le Règlement européen sur l’intelligence artificielle constitue un outil essentiel pour comprendre les enjeux juridiques et techniques que pose le RIA (ou AI Act). L’ouvrage analyse et souligne les points clé et analyse article par article ce texte...
La cobotique juridique #3 : Les malfaçons. Ce troisième épisode détaille les différents facteurs de malfaçons et comment les corriger...