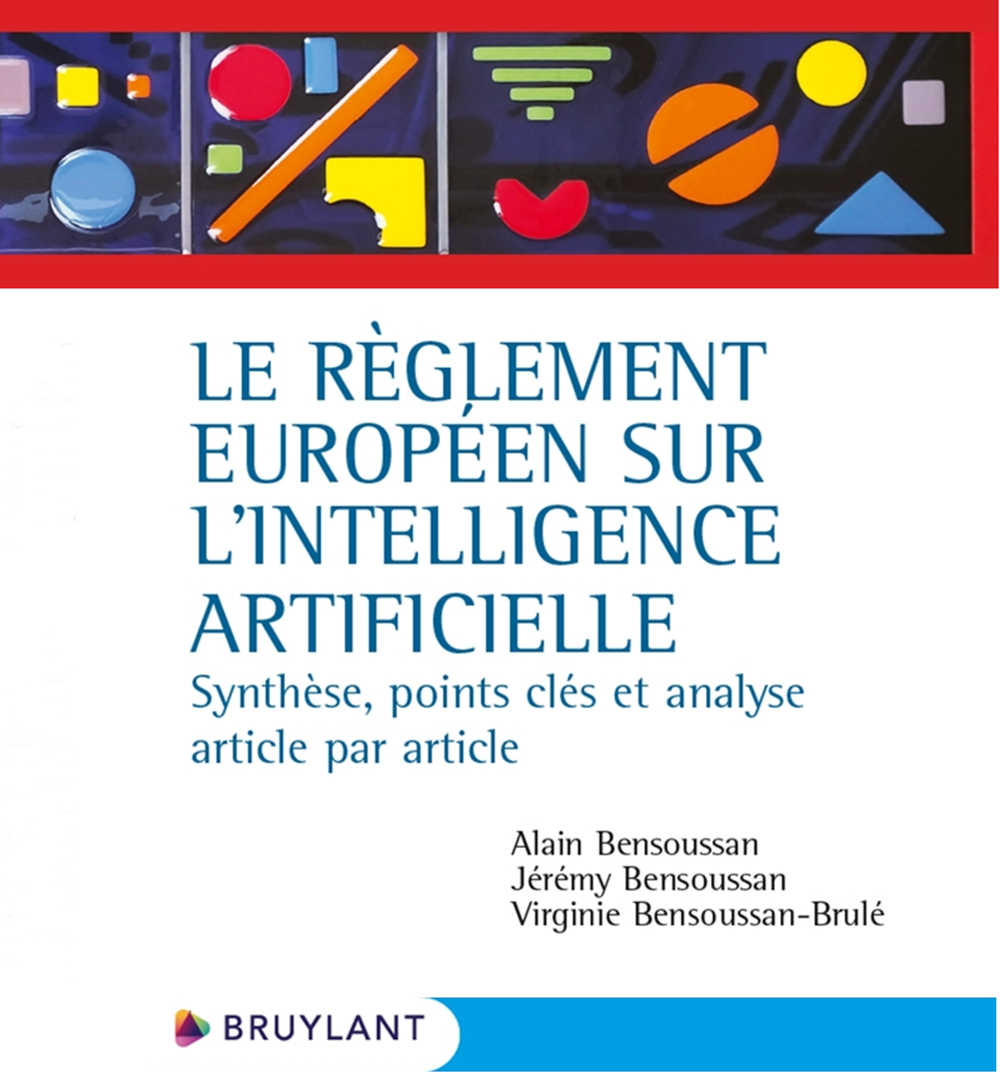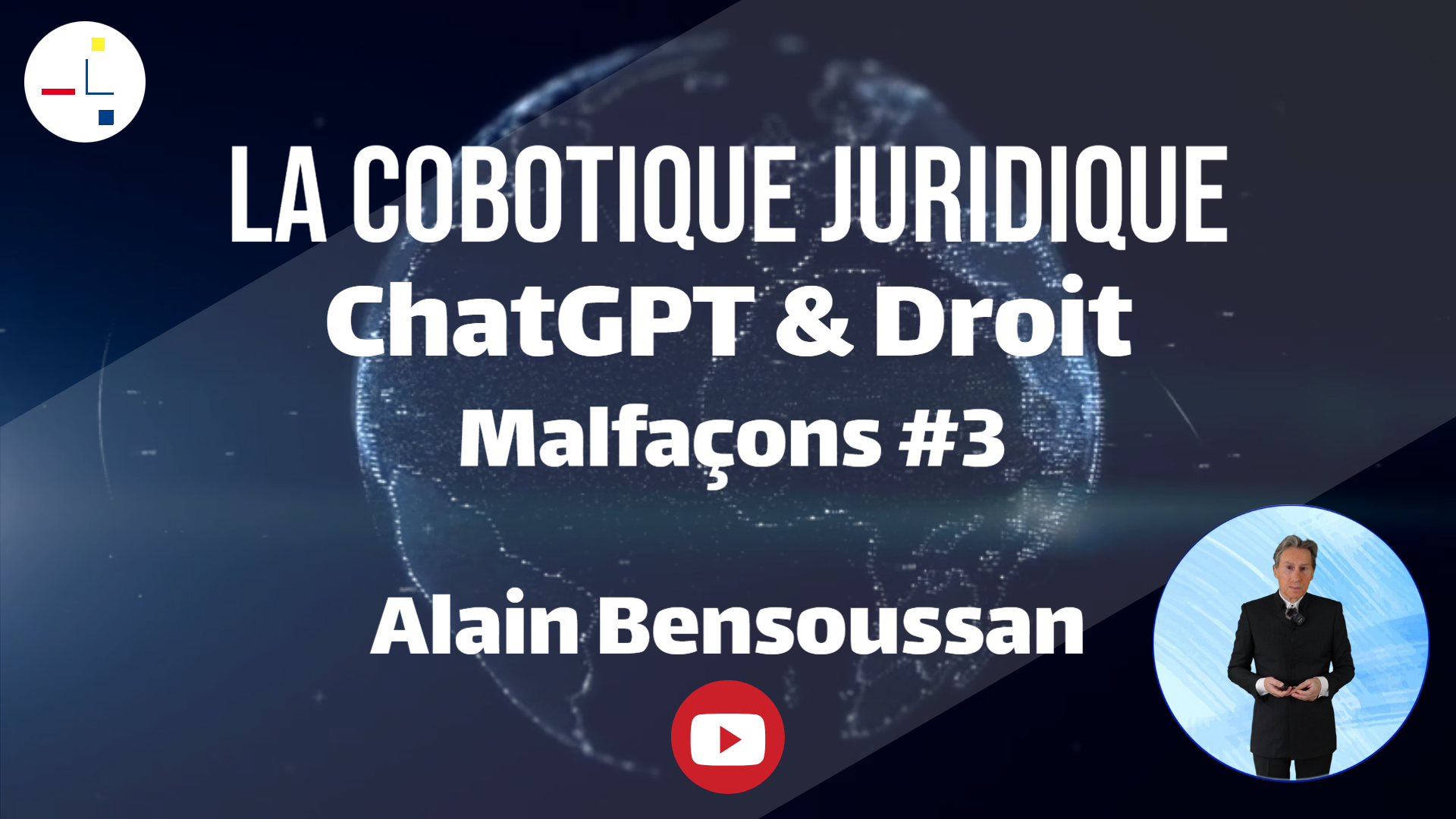Le droit s’applique au Street art
Les œuvres de Street art
Le street art recouvre des murs privés ou publics, en dehors de tout cadre contractuel. Ces œuvres peuvent être anonymes, parfois signées d’un pseudonyme, ou laissées sans signature. Lorsqu’elles présentent un caractère original, elles relèvent du régime du droit d’auteur prévu à l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Cet article reconnaît à l’auteur un droit de propriété incorporelle sur son œuvre, incluant des droits patrimoniaux et des droits moraux. Cette seconde catégorie de droits, au nombre desquels le droit au respect de l’oeuvre, est perpétuelle, inaliénable et imprescriptible. Il s’applique même à une œuvre créée illégalement dans l’espace public, dès lors que celle-ci est originale.

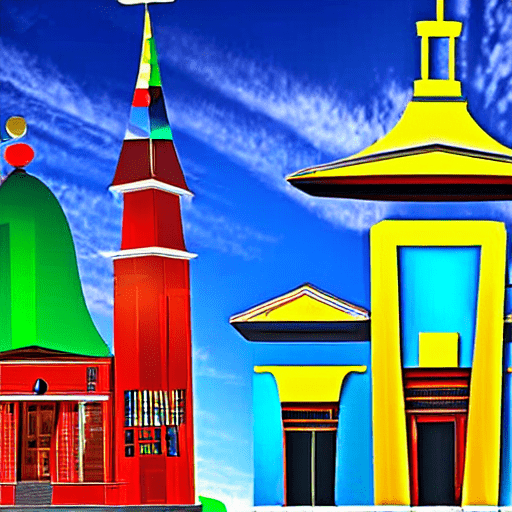
Le Street art : l'art dans l'espace urbain
Street art : droit d’auteur et propriété
Certains propriétaires constatent la présence d’une œuvre de street-art sur leur bien immobilier. Cette réalisation a été effectuée sans autorisation. Ils se trouvent en présence d’un conflit juridique entre la propriété matérielle du support et les droits immatériels de l’auteur sur son œuvre.
La suppression ou la modification de cette fresque peut engager leur responsabilité. L’exemple des mosaïques d’Invader en fournit une illustration concrète.
Ces œuvres, installées dans l’espace urbain sans autorisation, ont été jugées originales par le tribunal de grande instance de Paris dans un jugement du 14 novembre 2007 [1]. Le tribunal a considéré que leur originalité permettait de les protéger au titre du droit moral, en vertu de l’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle .
Propriétaire versus Artiste
Street art : droit d’auteur et propriété
Un propriétaire peut découvrir une œuvre apposée sans autorisation sur son mur ou son mobilier. Cette situation concerne aussi bien les établissements privés que les bâtiments publics.
L’intervention est souvent spontanée, sans contrat, et réalisée par un artiste inconnu ou pseudonyme. La fresque peut être signée, anonyme ou éphémère, ce qui rend son statut juridique complexe.
Le propriétaire s’interroge sur son droit à effacer ou modifier cette œuvre non sollicitée. Il craint d’engager sa responsabilité s’il détruit une création considérée comme originale.
Même sans accord préalable, l’artiste peut revendiquer un droit moral sur l’œuvre.
Même si le mur ou le mobilier lui appartient, l’œuvre peut relever du droit d’auteur. Ce droit s’applique même en l’absence d’identification claire de l’auteur.
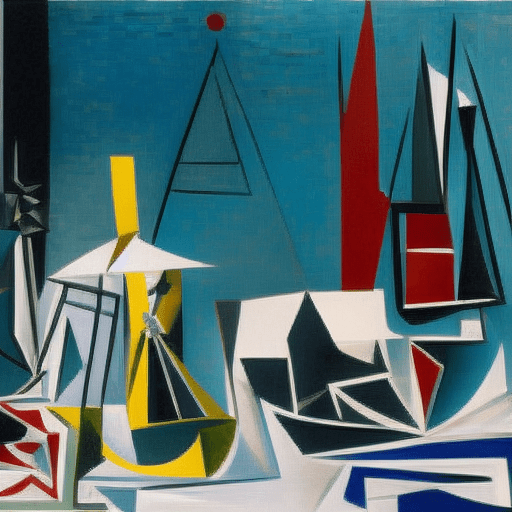

L'oeuvre de Street art a droit au respect
Street art : droit d’auteur et propriété
L’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle confère à l’auteur un droit au respect de l’intégrité de son œuvre. Il peut s’opposer à toute modification, altération ou destruction qui dénature l’esprit de sa création. Ce droit s’applique indépendamment des droits patrimoniaux, et subsiste même en cas de cession.
Le non-respect de ce droit peut entraîner une action en contrefaçon.
L’article L.335-3 du même code étend la notion de contrefaçon à toute violation des droits de l’auteur, y compris le droit moral. La formule « en violation des droits de l’auteur tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi » inclut l’ensemble des prérogatives, sans exception.
Ainsi, une altération de l’œuvre sans l’accord de l’auteur constitue une contrefaçon, même si l’œuvre est apposée sans autorisation.
L’exercice du droit d'auteur
Street art : droit d’auteur et propriété
Plusieurs décisions illustrent la rigueur des juridictions à l’égard des atteintes à l’intégrité d’une œuvre.
La Cour d’appel de Paris, le 24 juin 1994 [2], a condamné un maître d’ouvrage d’un immeuble ayant détruit une sculpture monumentale lors d’une restructuration. L’auteur avait préalablement sollicité une indemnisation de 4.000.000 francs. Le juge a reconnu une atteinte fautive au droit moral et a accordé 100.000 francs à titre de réparation, malgré l’absence de lien contractuel formel entre l’auteur et le propriétaire.
De manière similaire, le Tribunal de grande instance de Toulon, le 25 janvier 1999, a jugé que la suppression d’une fontaine publique constituait une atteinte à l’intégrité de l’œuvre. La commune a été condamnée à indemniser l’artiste à hauteur de 100.000 francs.
Ces décisions démontrent qu’un propriétaire ne peut justifier la destruction d’une œuvre que s’il a tenté d’établir un dialogue préalable avec l’artiste ou ses ayants droit.

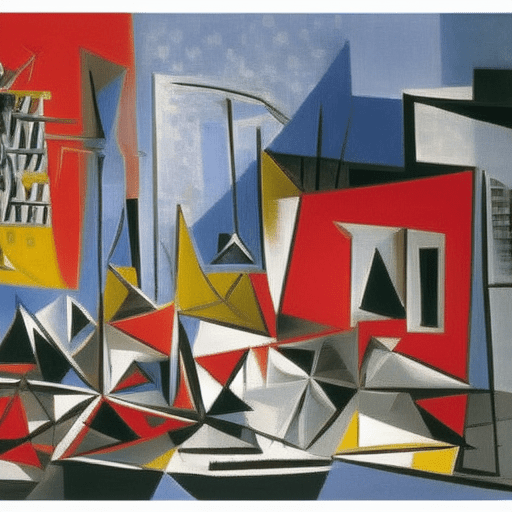
Le Street art et l’atteinte à l’intégrité de l’œuvre
Street art : droit d’auteur et propriété
L’article L.331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle encadre la réparation des atteintes aux droits d’auteur. Le juge prend en compte les conséquences économiques négatives subies par l’auteur, dont le manque à gagner, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé.
À défaut de preuve chiffrée, une indemnité forfaitaire peut être allouée. Cette somme ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur avait donné son autorisation.
Ce principe vise à replacer l’auteur dans la situation antérieure à l’atteinte, sans bénéfice ni perte injustifiée.
Le préjudice subi par l'artiste
Street art : droit d’auteur et propriété
La jurisprudence applique fréquemment une logique forfaitaire pour évaluer le préjudice moral.
Le Tribunal administratif de Montpellier, confirmé par la Cour administrative d’appel de Bordeaux [3], a accordé 50.000 francs à un sculpteur pour la destruction du socle d’une œuvre monumentale.
Le Tribunal de grande instance de Nanterre a reconnu un préjudice moral de 500.000 francs pour la destruction précipitée d’une maison d’habitation.
Dans l’affaire jugée par la Cour d’appel de Limoges du 30 mars 2011 [4], la disparition d’une sculpture conçue pour le hall d’une agence a conduit à l’allocation de 10.000 euros.
Ces décisions reposent sur l’idée que le droit moral subsiste indépendamment des droits patrimoniaux et que l’atteinte à la notoriété ou à la capacité de diffusion de l’œuvre constitue un préjudice à part entière.
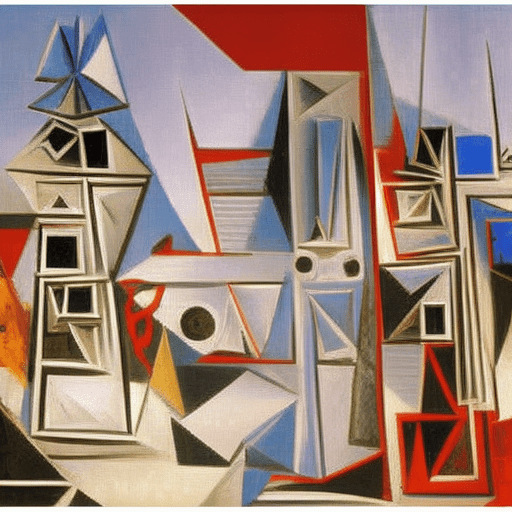
La sécurisation du Street art
Street art : droit d’auteur et propriété
Pour éviter un contentieux, le propriétaire doit formaliser un accord écrit avec l’artiste.
Ce contrat doit préciser la durée de présence de l’œuvre, son caractère éphémère, et inclure une autorisation expresse de retrait ou de destruction. Il est recommandé de prévoir une renonciation partielle au droit moral, dans les limites du droit français.
En l’absence de contrat, le propriétaire doit justifier d’une tentative sérieuse de contact avec l’auteur ou ses ayants droit. À défaut, toute suppression ou altération pourra faire l’objet d’une action en contrefaçon sur le fondement de l’article L.335-3 du CPI.
L’exemple d’Invader montre que les auteurs peuvent faire valoir leur droit moral sur des œuvres anonymes apposées sur des biens privés. Une stratégie juridique claire, fondée sur la documentation des démarches entreprises, demeure la meilleure protection du propriétaire.
- TGI Paris, 14-11-2007, n°06/12982
- CA Paris, 24-06-1994 (Dalloz, accès réservé)
- CA Bordeaux, 27-12-1990, n° 89BX01321
- CA Limoges, 30-03-2011, n°10/00172
Avec la collaboration de Louise Coursin, stagiaire, étudiante en première année de Droit à l’Université Paris-Saclay.

Marie Soulez
Avocate, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux

Marie Soulez
Avocate, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux
- Phone:+33 (0)7 85 53 57 52
- Email:marie-soulez@lexing.law
Pour en apprendre davantage
Le Règlement européen sur l’intelligence artificielle constitue un outil essentiel pour comprendre les enjeux juridiques et techniques que pose le RIA (ou AI Act). L’ouvrage analyse et souligne les points clé et analyse article par article ce texte...
La cobotique juridique #3 : Les malfaçons. Ce troisième épisode détaille les différents facteurs de malfaçons et comment les corriger...